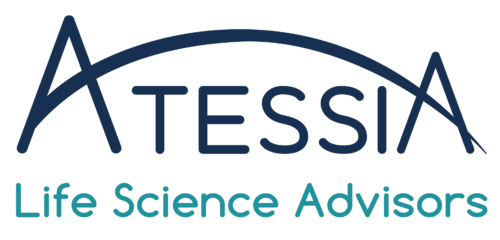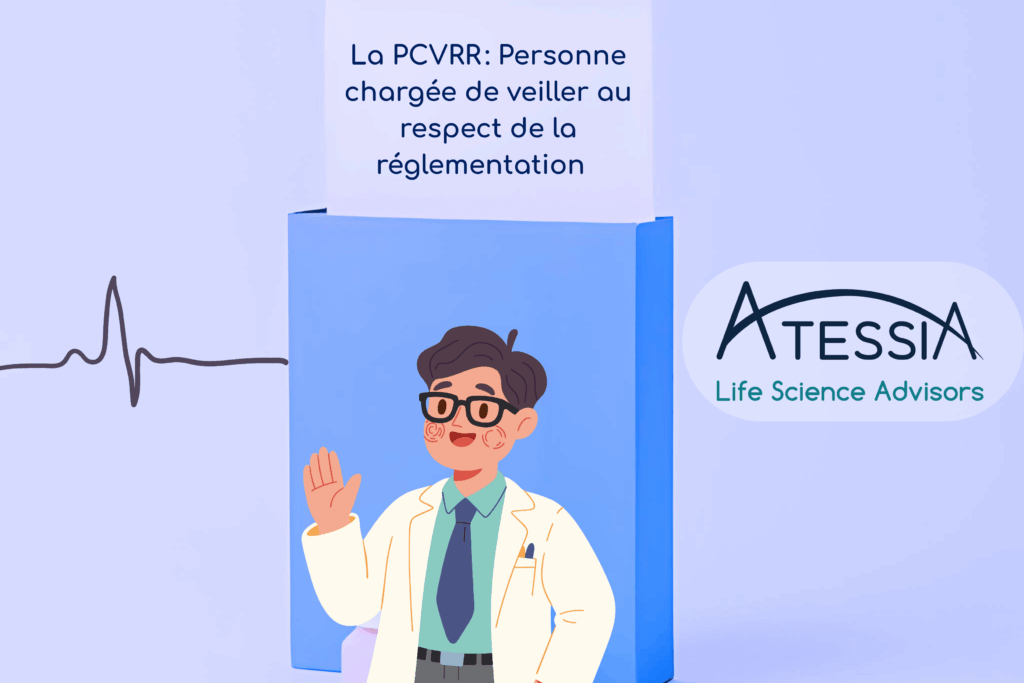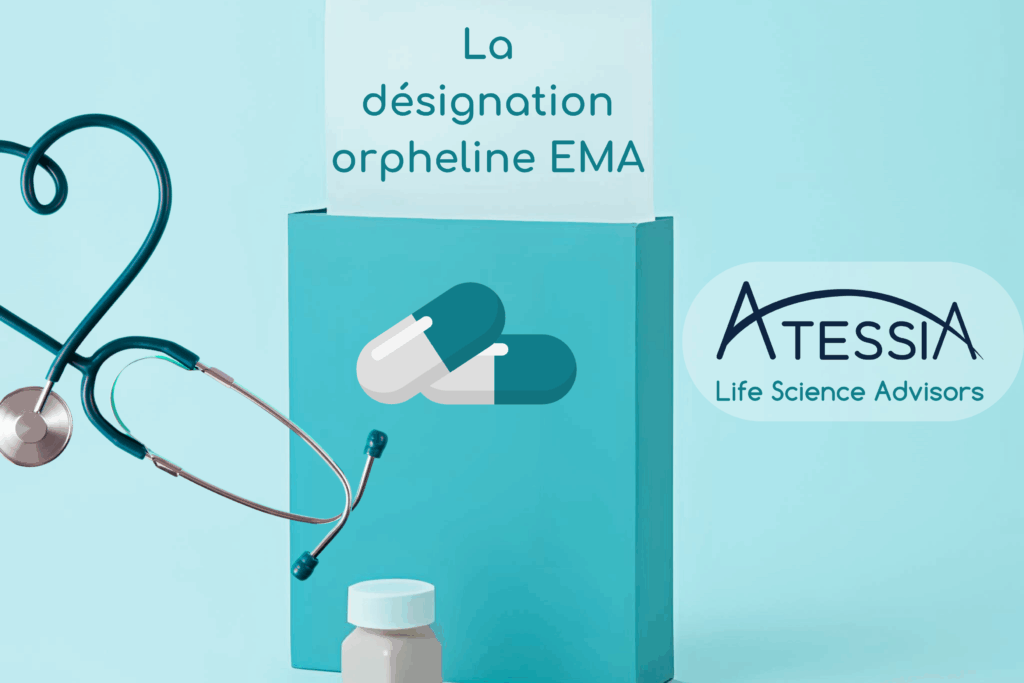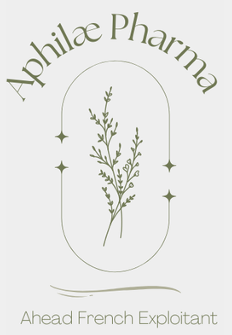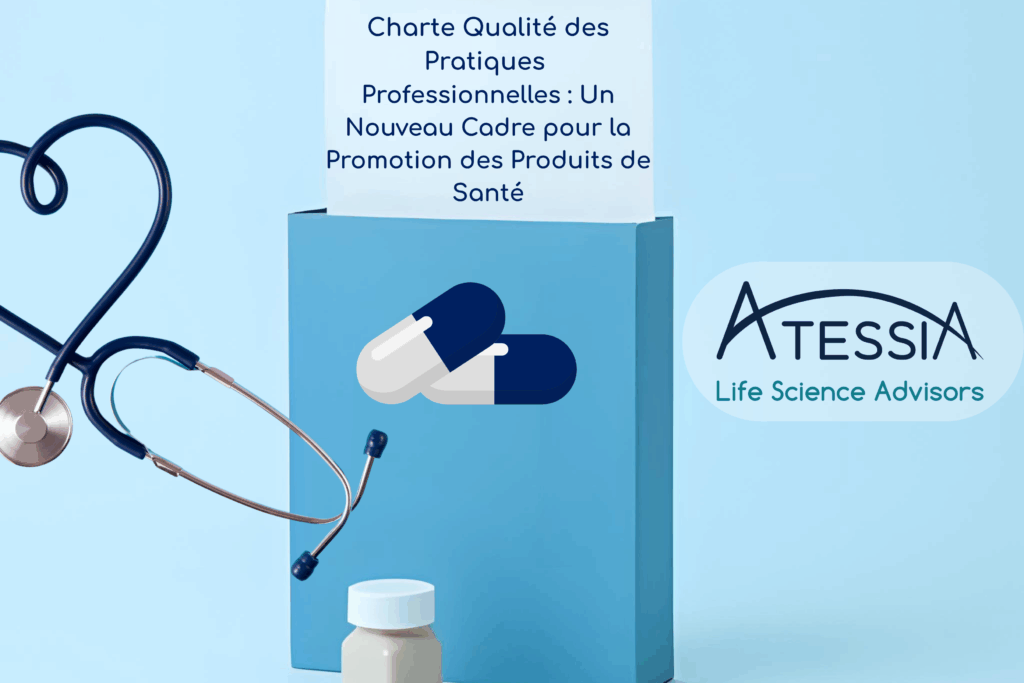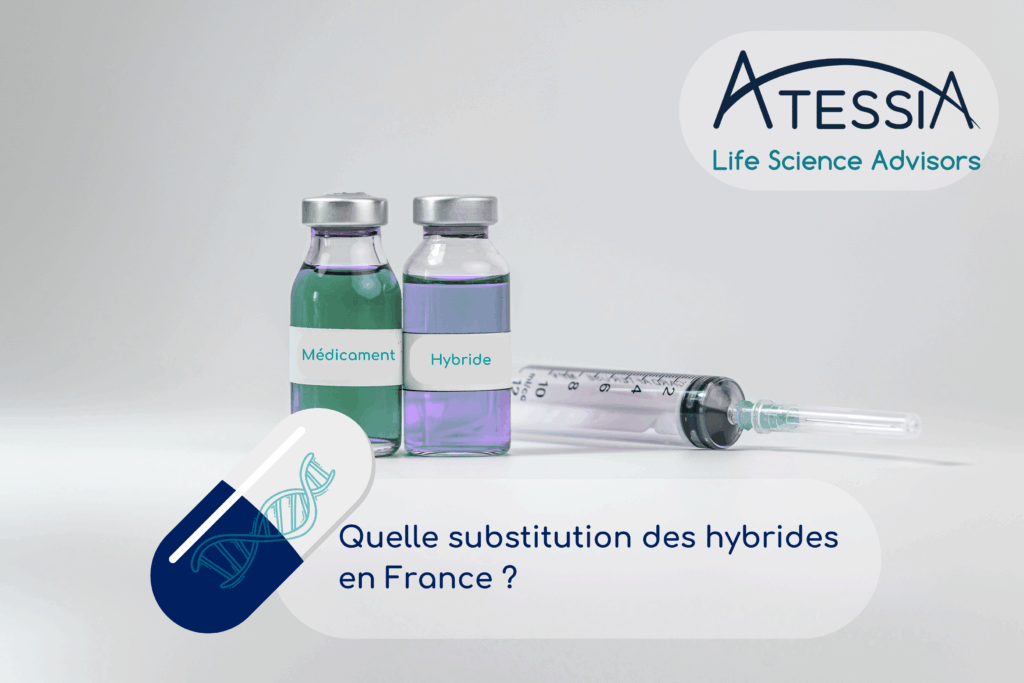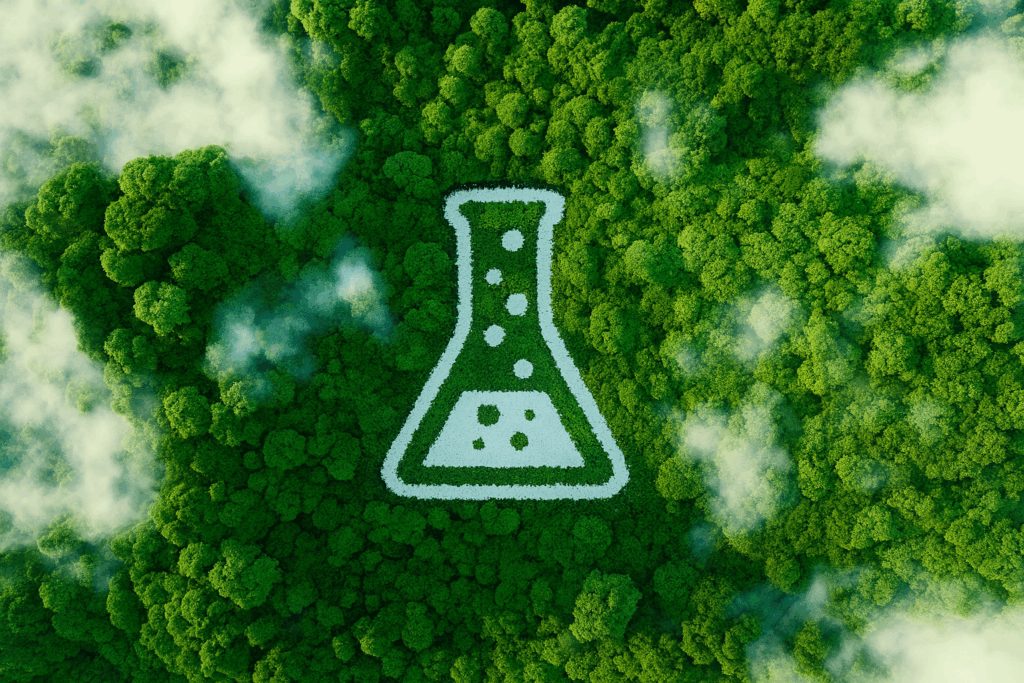Un enjeu environnemental structurant pour le secteur de la santé
L’industrie pharmaceutique, traditionnellement axée sur la sécurité et l’efficacité des traitements, est aujourd’hui confrontée à une attente croissante en matière de performance environnementale. Le secteur de la santé représente à lui seul environ 4,4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES), soit près de 2 gigatonnes de CO₂ par an. En France, l’empreinte carbone liée aux médicaments consommés est estimée à 26,3 millions de tonnes équivalent CO₂, ce qui représente près de 2 % des émissions nationales selon le Shift Project.
Face à ces chiffres, les autorités sanitaires et les industriels du médicament s’engagent dans une transformation progressive de leurs pratiques. L’objectif est double : répondre aux exigences réglementaires émergentes et s’adapter aux attentes sociétales croissantes en matière d’écoconception et de durabilité.
Une chaîne de production à forts impacts : GES, eaux, déchets et énergie
Émissions de gaz à effet de serre
La production pharmaceutique repose sur des procédés chimiques et logistiques fortement émetteurs. Si les émissions directes des sites industriels ont baissé (–11 % d’électricité consommée depuis 2012 en France), le principal levier reste la réduction des émissions indirectes (scope 3) liées aux fournisseurs, au transport et à l’usage final des médicaments — représentant près de 90 % de l’empreinte carbone du secteur.
Résidus médicamenteux dans l’eau
Des études récentes ont confirmé la présence ubiquitaire de résidus de médicaments dans les cours d’eau mondiaux. Une étude de 2022 indique que 100 % des rivières analysées dans 104 pays contenaient des traces de principes actifs, avec des concentrations préoccupantes pour la biodiversité aquatique dans un quart des cas. Ce phénomène contribue également à l’antibiorésistance environnementale, un enjeu de santé publique.
Déchets pharmaceutiques et emballages
La gestion des médicaments non utilisés (MNU) reste un défi logistique et environnemental. En France, le dispositif Cyclamed permet de collecter et détruire les MNU — 9 415 tonnes récupérées en 2022, soit environ 70 % des volumes estimés. Parallèlement, les emballages primaires et secondaires (cartons, blisters, notices) représentent une part importante des déchets générés. Des efforts de réduction à la source et de recyclabilité sont en cours.
Consommation de ressources et solvants
Les procédés de fabrication consomment massivement de l’eau, des solvants et de l’énergie. Certains composants, comme les hydrofluoroalcanes (HFA) utilisés dans les inhalateurs doseurs, ont un impact climatique élevé. Des alternatives moins polluantes sont en développement, notamment via des inhalateurs à poudre sèche ou de nouveaux propulseurs à faible GWP (Ventoline de GSK). En parallèle, de nouvelles obligations d’étiquetage s’imposent aux titulaires d’AMM d’inhalateurs dosseurs (MDI) contenant des gaz à effet de serre fluorés (F-gases) en tant qu’excipients, ainsi que des incitation à remplacer les hydrofluorocarbones (HFC) par d’autres gaz propulseurs.
Un cadre réglementaire en mutation : de l’évaluation à l’action
Nouvelles exigences environnementales de l’EMA
Depuis 2006, une évaluation du risque environnemental (ERA) est obligatoire pour les nouvelles demandes d’AMM. Mais à partir de septembre 2024, l’EMA impose des exigences renforcées, avec une prise en compte obligatoire de ces risques, y compris pour les médicaments déjà commercialisés. Dans le cadre de la refonte en cours de la législation pharmaceutique en Europe, un changement de paradigme est à attendre avec la prise en compte de l’impact environnemental de la fabrication à l’élimination, avec un mécanisme de rattrapage pour les molécules d’avant 2005 potentiellement dangereuses pour l’environnement.
Le principe du pollueur-payeur appliqué aux eaux usées
La révision de la directive européenne sur les eaux urbaines résiduaires introduit une responsabilité élargie des producteurs de médicaments, contraints de financer 80 % des coûts de traitement avancé des résidus pharmaceutiques et cosmétiques. Cette mesure vise à limiter la contamination des milieux aquatiques d’ici 2035, notamment dans les grandes stations d’épuration. Les industriels devront également publier les données environnementales associées à leurs produits, dans un souci de transparence accrue.
Écoconception et emballages durables
Le règlement (UE) 2024/1781 sur les produits durables impose aux laboratoires des standards d’écoconception. À terme, les emballages pharmaceutiques devront intégrer des matériaux recyclés et limiter le recours aux plastiques à usage unique. En parallèle, la loi AGEC en France fixe notamment l’objectif de suppression des emballages plastiques jetables d’ici 2040.
La feuille de route française : une écologie appliquée à la santé
Le ministère de la Santé a lancé une planification écologique du système de santé, avec l’ANSM en pilote pour le médicament. Parmi les actions : expérimentation de la notice dématérialisée, délivrance des antibiotiques à l’unité, prolongation des durées de péremption et retraitement de dispositifs médicaux. Ces orientations s’inscrivent dans une logique de sobriété et de réduction du gaspillage pharmaceutique.
Des laboratoires qui accélèrent leur transition
Plans climat et neutralité carbone
De nombreux industriels se sont engagés sur des trajectoires compatibles avec les objectifs de l’Accord de Paris. En France, le Leem a publié un plan sectoriel de décarbonation pour viser la neutralité carbone d’ici 2050. Les actions portent sur l’efficacité énergétique, l’adoption d’énergies renouvelables, et la réduction des émissions liées à la logistique.
Écoconception et chimie verte
Le laboratoire Servier a déployé un programme EcoDesign pour intégrer les critères environnementaux dès la R&D. L’usage de solvants durables, l’évaluation systématique des impacts via un “green score” et la sélection de molécules moins persistantes deviennent des standards. D’autres acteurs comme Pfizer ou Merck appliquent les principes de la chimie verte pour réduire les déchets et la consommation énergétique.
Réduction et recyclage des emballages
Les initiatives incluent la réduction des volumes de conditionnement, l’usage de plastiques recyclés, ou la suppression progressive des notices papier. Boehringer Ingelheim, par exemple, teste un programme de recyclage des inhalateurs usagés. Ces efforts visent une meilleure circularité des matériaux tout en réduisant l’impact environnemental.
Mobilisation collective et culture RSE
Des alliances comme Net Zero Carbon Healthcare ou Pharmaceutical Supply Chain Initiative favorisent le partage de bonnes pratiques. Le Leem accompagne les PME avec des outils mutualisés (diagnostics carbone, guides RSE). Cette dynamique traduit une évolution culturelle en profondeur, encouragée par les prescripteurs et les patients. La nouvelle méthodologie de calcul de l’empreinte carbone des médicaments développée par Ecovamed dans le cadre de « The Shift Project », vise à harmoniser l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie des médicaments.
Conclusion : vers une industrie du médicament durable et responsable
L’industrie pharmaceutique est engagée dans une transformation environnementale de fond. Sous l’effet combiné de la réglementation et des pressions sociétales, le secteur revoit ses procédés, ses produits et ses emballages. Pour les professionnels de santé, cette transition est aussi une opportunité : celle de participer activement à la réduction de l’empreinte écologique du médicament, par une prescription raisonnée, une sensibilisation des patients et un choix éclairé des traitements. La santé de demain devra être aussi durable que curative.